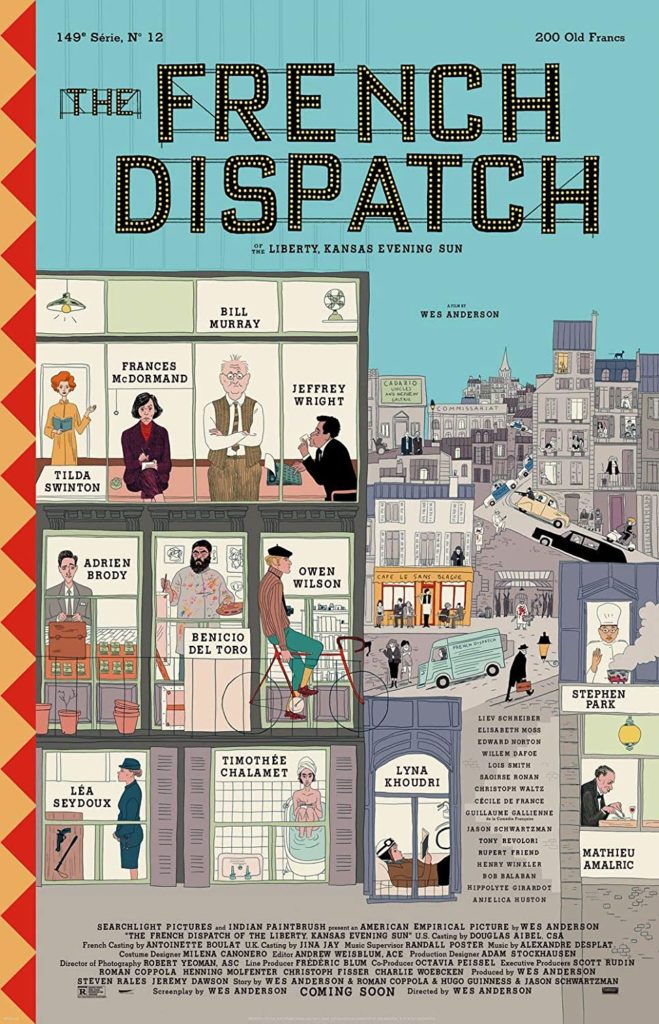
Difficile d’accéder à The French Dispatch sans avoir cette arrière-pensée, quasi permanente, selon laquelle le cinéma de Wes Anderson tourne désormais à circuit fermé. Wes Anderson se serait-il contenté de faire du Wes Anderson ? Ou bien son dernier film, initialement prévu pour une sortie en 2020, n’aurait-il pas justement pour objet Wes Anderson se contentant de faire du Wes Anderson ? Difficile déjà de ne pas voir un trait explicite dans le nom opératique de la ville fictive où se situe l’action : Ennui-sur-Blasé. De plus, le récit prend place au sein d’un organisme de presse, The French Dispatch, juste après la mort de son rédacteur-en-chef originaire du Kansas. Difficile alors de résister à l’appel d’une interprétation autobiographique, Wes Anderson étant lui-même né au Texas avant de s’être désormais installé en France. Peut-être trouve-t-il un certain charme à s’ennuyer en ce pays, s’il lui en donne le temps ? « The French Dispatch » narre ensuite trois sketchs, mettant en image les dernières pages de la revue avant qu’elle ne s’éteigne. Rigoureusement mis en page, le film commence tout de même par l’apparition d’un journaliste nous faisant visiter, du haut de sa bécane, Ennui-sur-Blasé. Il va bien vite et est très clair, mais à aucun moment il ne prend la précaution de regarder devant lui. Forcément, il finit par se casser la tête, laissant le vélo continuer sans lui, tournant à vide. Bel avant-gout de ce qui va suivre.

« The French Dispatch » démarre sur les chapeaux de roue par un premier sketch virevoltant, narrant l’histoire de la vie de Moses Rosenthaler, peintre purgeant une peine de prison pour un double assassinat sur fond de grognement, et dont le talent se fait repérer alors qu’il croupie dans sa cellule, solidement surveillée par Simone, sa gardienne dont il va faire sa muse. Encore une fois, Wes Anderson semble synthétiser, avec toutes ses circonlocutions habituelles, ses intentions : à l’instar de Rosenthaler avec la peinture en prison, son art de cinéaste aura rarement été autant pointilleux que lorsqu’il se referme sur lui-même, comme si son style si particulier s’était, pour lui, transformé en quatre murs. D’ailleurs, « The French Dispatch », autant que les autres films d’Anderson, fourmille de motifs carcéraux, ou du moins propres à l’enfermement : maints surcadrages, avion dont l’image scinde l’apparence pour nous en montrer les coulisses, étudiants bloquant l’université, éclatement des espaces (l’image passant d’une pièce l’autre sans coupe) bureau où les émotions sont interdites, commissariats, otages, prostituées, complexes (le personnage de Chamalet), manières (celui de Tilda Swinton)… Chaque composante se voit enfermée, recluse, avec comme seul échappatoire visible les langues se déliant sous le manteau : les excuses, la vulgarité, le morse…

Cette pertinence avec laquelle Anderson observe l’avancement de son œuvre (ce ne sont plus uniquement ses personnages qui sont enfermés dans la mise en scène, mais aussi désormais sa propre personnalité de cinéaste) n’empêche cependant pas « The French Dispatch » de vite perdre son élan dans les sketchs suivant, appréciables pour quelques fulgurances sans pour autant cultiver la verve du premier, achevant de donner au film sa funeste allure inégale et pour finir, claudicante. Pourquoi user d’un tel terme, vous demanderez-vous ? Tout simplement parce que tel un boiteux, le film se refuse à sortir de sa zone de confort, tournant la caméra ailleurs lorsque ça cogne, se transformant en gigantesque théâtre visuel avare en précision mais dénué d’existence, s’effaçant derrière ce que l’on attend de lui. Mais peut-etre, pour défendre un tel discours, sommes nous simplement blasés du cinéma de Wes Anderson, lequel, dans un monde idéal, se serait achevé après « The Grand Budapest Hotel » ? Car « The French Dispatch » répète bien la même recette du cupcake filmique, avec l’imprégnation en moins… Difficile alors d’être surpris, où même de ressentir quelque chose de fort. Mais comme le disait ma voisine de siège, « de-toute-façon-on-l’aimera-quoi-qu’il-arrive ! ».
Boyen LaBuée lui attribue la note de :
En bref
« De toute façon on l’aimera quoi qu’il arrive ! »
